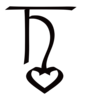Cohabiter avec ses personnages
Lorsqu’on ne dispose pas d’assez de temps libre pour écrire au rythme souhaité, on en vient à devoir conserver une partie de ses histoires en gestation. Il nous faut attendre avant de pouvoir les transposer et mûrir. Or, un récit comporte des personnages. Lesquels cherchent à s’incarner. Sous la plume, certes, mais ils sont bel et bien vivants. Oh, sous notre crâne seulement, ils peuplent nos pensées et peuvent surgir à des moments incongrus.
Il n’est pas rare de perdre le fil d’une discussion, de se distancier de la situation et d’apprécier le déroulement de la scène tel un scénario qui se déroule sous nos yeux. Les archétypes prennent place, les dialogues s’enchaînent et il est alors difficile de redevenir acteur. Les personnages qui ne sont pas fixés sur le papier, tels des sujets, agissent avec un certain libre arbitre. A ce stade, vous vous dites que je suis schizophrène. Non. Je suis rédactrice, hantée par des histoires que je n’ai pas le temps d’écrire, tout simplement.
Je me sens seule, et pourtant habitée ! Parfois à l’étroit dans ma propre tête, j’admets. Seule face à une situation où les dérivatifs deviennent faible face à la consistance des mondes qui semblent avoir acquis une autonomie propre, presque malgré moi. Ce que je vis vient s’intercaler ci et là, avec un parfait naturel. Étrange, n’est-ce pas ?
Oh, banal syndrome de l’écrivain solitaire et peut productif, diront d’autres.
L’inspiration est là, pressante, mais il n’y a pas d’espace suffisant pour la laisser se déployer, pour prendre le temps d’arpenter les voies de la création. Constat. Ni amer ni triste, simple transcription d’un phénomène qui doit probablement arriver à d’autres aussi.
Mais vraie problématique.
Certes, je goûte ce temps d’observation, de maturation. Mais je regrette tout de même de ne pouvoir parler d’assiduité, me perdre des heures durant – voir des jours entiers ! – dans la rédaction. Ce temps viendra, et il sera libératoire, oh oui ! Néanmoins, avoir conscience du processus en cours ne le rend pas pour autant évident à vivre. C’est même plutôt déroutant. Les mots s’affûtent grâce au travail quotidien, les techniques se travaillent. Mais la jubilation manque, celle qui nous fait courber l’échine, avoir mal au poignet et aux doigts, finir la nuque raide et les yeux écarquillés, comme hagards, au sortir d’heures passées à vidanger son esprit. A laisser libre court à son imagination, à réfléchir, construire, raturer et recommencer de plus belle. Celle qui nous étreint, lorsqu’après la seconde ou troisième réécriture, le rythme est là, la tonalité sonne juste et le texte est fluide. Il se déroule sans accroc, se faisant support à l’imagination d’autrui. Coulant avec naturel pour mieux se faire oublier. L’humilité de ne pas chercher à placer ces petites formules qui sonnent bien, de rester dans la veine initiale et de respecter l’esprit. Ce moment où après deux lectures d’affilée, à la recherche des dernières retouches, il n’y a rien. Rien à enlever, rien à ajouter ni à modifier. La tension est bonne, l’intensité présente, les parties se suivent et s’articulent en souplesse. Le tableau est achevé. Les personnages y vivent avec naturel.
Cet instant de paix, ce sentiment d’équilibre. Et cette autorisation : se donner à lire à autrui. Parce que le texte est abouti.
Quête de ces trop rares instants d’Éternité donc, ponctuée de dialogues intérieurs, scènes qui se jouent en parallèle de ma vie, s’invitent dans les rêves, les rêveries, les moments de pause.
Lever de rideau sur des périodes souvent occultées mais pourtant bien réelles. Alors oui, les écrivains vivent dans leurs mondes. Mais je dirais plus sûrement que les mondes habitent les écrivains. Et que les fixer est une nécessité, question d’hygiène mentale en somme 🙂